Jeudi 26 juin 2025, 15h-17h, amphi 5
Table ronde proposée par l'Association française des Arabisants
Aujourd'hui encore, dans les départements d'arabe et de sciences humaines et sociales, les compétences linguistiques passent trop souvent après les compétences disciplinaires. Il y a à cela de multiples causes, liées tant aux structures de l'enseignement supérieur qu'à un certain nombre de préjugés tenaces, concernant en particulier la place et le statut de la langue arabe en France. En dépit des progrès réalisés ces dernières années, notamment à l'initiative du GIS MOMM (prix de thèse IMOMM, académie doctorale HoRÉA-Maghreb 3D, projet SHS en traduction...), il reste beaucoup à faire.
Un archéologue peut-il fouiller efficacement un site d'époque islamique au Liban ou en Irak sans pouvoir lire les sources textuelles en langue arabe qui évoquent ou mentionnent ce site ? Un politologue peut-il mener des recherches de fond sur le Hezbollah s'il n'a pas accès aux discours en arabe des responsables de ce parti et des entretiens qu'ils ont accordés à des médias arabophones ? Un sociologue peut-il mener des enquêtes approfondies en pays arabes s'il doit, pour réaliser ses entretiens, faire appel à un interprète ou utiliser une langue tierce, qui n'est ni la sienne ni celle de l'enquêté (l'anglais, par exemple) ? Un diplomate n'est-il pas mieux armé pour représenter la France s'il parle la langue du pays où il exerce et peut s'entretenir sans truchement avec ses interlocuteurs ? Intuitivement, il ne fait aucun doute que mieux un chercheur ou un fonctionnaire maîtrisera la langue de l'aire culturelle sur laquelle il travaille, et mieux ses recherches ou son travail s'en porteront.
Quels sont les dispositifs à mettre en place pour améliorer la formation linguistique des étudiants et des chercheurs et leur donner les moyens linguistiques nécessaires pour mener à bien leurs recherches ou leurs missions ? C'est à dresser un état des lieux et à réfléchir à des solutions adéquates et efficaces que cette table-ronde sera consacrée.
Questions pour alimenter le débat :
1) Quelles sont les demandes et les besoins des étudiants et des chercheurs ?
2) Comment l'enseignement universitaire peut-il y répondre mieux avec les moyens dont nous disposons ? En particulier, comment mieux intégrer les besoins de spécialistes d'autres disciplines dans nos formations en langue arabe ?
3) Quelle place accorder aux différentes variétés d'arabe (certifications, LANSAD, concours) ?
Ces questions débouchent sur un certain nombre de problématiques, liées notamment aux types et à la structure des formations proposées, aux méthodes de travail, aux manuels et ressources disponibles/utilisés, à la place des compétences (CECRL), aux volumes horaires (année zéro, cours pour « non spécialistes »), à la continuité de l'apprentissage (entre deux années universitaires, par exemple), à la mobilité et à l'immersion, à la formation des enseignants, aux dispositifs interuniversitaires à mettre en place et aux moyens disponibles pour cela.
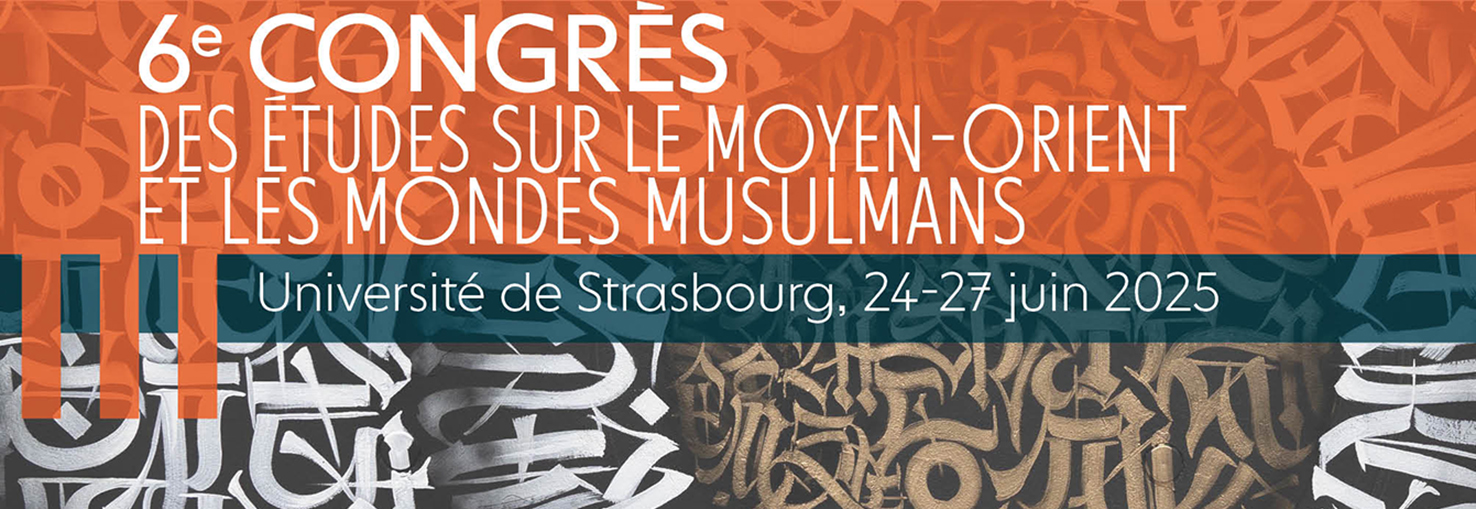
 PDF version
PDF version
